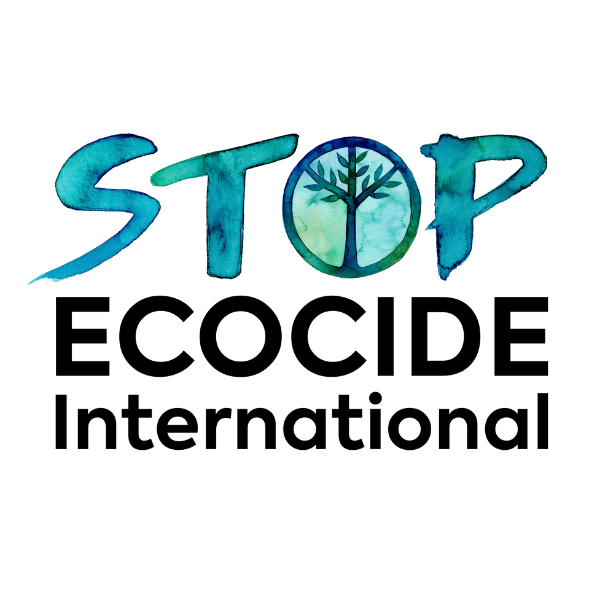Défendre la Perle de l’Afrique : l’urgence de criminaliser l’écocide en Ouganda
Ce blog est rédigé par Ninsiima Louis Kandahura, défenseur du climat et conteur, et Calvin Stewart Obita, défenseur des droits de l'homme.
L'Ouganda, souvent surnommée la « Perle de l'Afrique », abrite des forêts luxuriantes, des sols fertiles et de vastes zones humides. Pourtant, ces richesses naturelles disparaissent à un rythme alarmant. La destruction de l'environnement n'est plus seulement une menace pour la biodiversité, elle constitue une crise qui mine les moyens de subsistance, les cultures et les droits fondamentaux. Dans ce contexte, un concept requiert une attention urgente : l'écocide.
L'écocide en contexte
La notion d'écocide, c'est-à-dire la destruction de nos écosystèmes, a émergé pour la première fois au niveau mondial pendant la guerre du Viêt Nam, lorsque l'usage de l'Agent Orange a décimé des forêts et empoisonné des générations entières. Des juristes tels que Richard Falk et Lynn Berat ont ensuite élargi ce concept, en le liant à la destruction d'espèces ou d'écosystèmes entiers. En 2021, un groupe d'experts indépendants réuni par la Fondation Stop Ecocide a proposé une définition: actes illicites ou arbitraires commis en connaissance de la réelle probabilité que ces actes causent à l’environnement des dommages graves, qui soient étendus ou durables.
Bien que l'écocide ne soit pas encore reconnu par la Cour pénale internationale, il a pris de l'ampleur dans le monde. Treize pays l’ont déjà inscrit dans leur droitnational, et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples consacre le droit collectif à un environnement satisfaisant.
Le cadre juridique de l'Ouganda
La Constitution ougandaise garantit explicitement le droit à un environnement sain en vertu de l'article 39. Les tribunaux ont affirmé ce principe dans plusieurs affaires emblématiques. Dans l'affaire Greenwatch c. Attorney General & NEMA (2002), la Haute Cour a reconnu que les groupes de la société civile pouvaient intenter des actions pour des atteintes environnementales, même en l'absence de préjudice personnel direct. De même, dans l'affaire ACODE v Attorney General & NEMA (2004), la Cour a rappelé l’obligation de l'État de prévenir la dégradation de l'environnement.
Cependant, les recours restent essentiellement civils ou administratifs, insuffisants face à des destructions irréversibles, comme la disparition totale de zones humides ou de forêts entières. Les dommages-intérêts civils ne peuvent pas restaurer un écosystème qui a été anéanti. La responsabilité pénale est la pièce manquante.
L'affaire Tsama William & Others v Attorney General illustre cette lacune. Les communautés de Bududa, longtemps touchées par des glissements de terrain meurtriers, ont poursuivi l'État pour n'avoir pas mis en place des mesures de protection efficaces. Le tribunal n'a pas encore rendu son jugement, mais l'affaire met en évidence les limites du cadre actuel de l'Ouganda : des catastrophes environnementales prévisibles dévastent des communautés, mais la loi peine à tenir qui que ce soit véritablement responsable.
Girafe dans le parc national de Murchison Falls, en Ouganda. Crédit : Ivan Sabayuki/ Unsplash.
L'écocide, une question de droits de l'homme
Le lien entre l'écocide et les droits de l'homme est évident. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples l’a affirmé dans l'affaire SERAC contre Nigeria, condamnant le gouvernement nigérian pour ne pas avoir protégé le peuple Ogoni contre les dégâts environnementaux dus à l'exploitation pétrolière. La Commission a rappelé que les droits environnementaux sont indissociables des droits à la vie, à la santé et à la dignité.
L'Ouganda a des obligations similaires en vertu de traités comme le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention relative aux droits de l'enfant, qui imposent une protection contre la dégradation environnementale. Pour les peuples autochtones tels que les Batwa, dont la survie culturelle et physique dépend des écosystèmes forestiers, la déforestation équivaut à une extinction culturelle.
Pourquoi la loi sur l'Ouganda a besoin d’une loi sur l'écocide
La constitution et les lois ougandaises reconnaissent les droits environnementaux, mais en l'absence d'une législation sur l'écocide, leur application reste faible. Criminaliser l'écocide permettrait d'aligner la législation nationale sur les normes internationales en matière de droits de l'homme, garantissant ainsi que la destruction de l'environnement à grande échelle fasse l'objet d'une véritable responsabilisation.
Une telle loi ne se limiterait pas à sanctionner, elle dissuaderait aussi. Elle affirmerait que les dommages graves, étendus ou durables causés aux écosystèmes ougandais ne sont pas de simples « dommages collatéraux » du développement, mais bien des crimes contre les peuples, la culture et les générations futures.
Conclusion
L'écocide n'est pas une théorie juridique abstraite. C'est une réalité vécue par les communautés ougandaises, confrontées aux inondations, glissements de terrain et à l'effondrement écologique. Nos tribunaux ont reconnu le droit à un environnement sain, mais des droits sans moyens d’application restent fragiles. En érigeant l'écocide en crime, l'Ouganda donnerait un sens concret à ses engagements constitutionnels et rejoindrait le mouvement international pour défendre la Terre, notre maison commune.
Il est temps d'agir, avant que la « Perle de l'Afrique » ne soit irrémédiablement perdue.