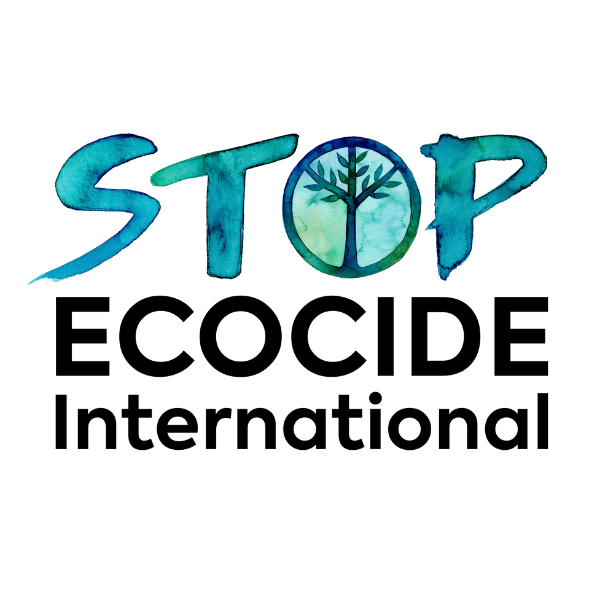La répression des manifestations pacifiques face à l’impunité de l’écocide
Par Pia Björstrand, avocate spécialisée en droit de l’environnement et associée chez Omnia Legal, Stockholm
Dans son arrêt de juillet, la Cour suprême suédoise a apporté une correction bien nécessaire à une tendance inquiétante. Dans une affaire concernant des militants pour le climat qui avaient brièvement bloqué une grande autoroute pour souligner l'importance de la restauration des zones humides et l'accélération de la crise climatique, la Cour a jugé que la manifestation ne constituait pas un sabotage. Bien que perturbatrice, l'action était clairement l'expression des droits constitutionnels des manifestants à la liberté de réunion et d'expression.
En tant qu’avocate spécialisée en droit de l’environnement, j’ai accueilli cette décision favorablement. Mais je ne peux m’en satisfaire, car partout en Europe, et bien au-delà, l’espace accordé à la manifestation pacifique se réduit à grande vitesse.
En Suède, des dizaines de militants pour le climat ont été arrêtés, placés en détention et poursuivis ces dernières années pour des actions de désobéissance civile non violente. Il s’agit pourtant d’actes symboliques, soigneusement réfléchis : sit-in sur la voie publique, blocages, perturbations destinées non pas à causer des dommages, mais à attirer l’attention sur eux. Malgré cela, leurs auteurs sont poursuivis pour des infractions graves, dont le sabotage, un crime passible de lourdes peines d’emprisonnement.
Dans la plupart des systèmes juridiques, le droit d'agir en situation d’urgence est reconnu, même si cela implique d’enfreindre la loi. Face à l’ampleur et à l’urgence de la crise écologique, comment la désobéissance civile pourrait-elle ne pas être justifiée, moralement ou même juridiquement ?
L’arrêt de la Cour suprême constitue un pas dans la bonne direction. Il réaffirme, quoique de manière limitée, que la démocratie doit laisser une place à la protestation morale, en particulier lorsque la loi accuse un retard sur la science et que l’inaction politique met en péril des écosystèmes entiers, ainsi que les vies et les moyens de subsistance qui en dépendent. Mais il ne devrait pas être nécessaire que la plus haute juridiction du pays se prononce pour rappeler qu’une manifestation pacifique n’est pas un crime.
La véritable contradiction persiste : alors que les lanceurs d’alerte sont punis, ceux qui profitent de la destruction de la nature poursuivent leurs activités sans être inquiétés.
Militant écologiste sur le pont de Lambeth, Londres, en 2022. Crédit : Alisdare Hickson / Creative Commons 2.0.
Ce problème ne concerne pas seulement la Suède. Au Royaume-Uni, une vague de lois anti-manifestations a provoqué une hausse spectaculaire des arrestations, visant aussi bien des syndicalistes que des militants pacifistes et écologistes. Plus tôt cette année, plus de 70 personnes ont été interpellées lors d’une marche pro-palestinienne à Londres, parmi lesquelles figuraient des dirigeants syndicaux et des figures reconnues de la société civile. Des organisations de défense des droits humains ainsi que des juristes ont condamné ces évolutions comme une atteinte grave aux libertés démocratiques. La Public Order Act de 2023 a introduit de nouvelles infractions aux contours très larges, comme le locking-on (le fait de s’enchaîner à un objet) ou l’« entrave aux infrastructures essentielles », criminalisant des tactiques de manifestation utilisées de longue date par les mouvements pour le climat et la justice sociale. En vertu de cette loi, les manifestants s’exposent à des peines de prison non seulement pour des actions directes non violentes, mais aussi simplement pour avoir transporté des objets jugés « susceptibles » de servir à perturber une manifestation. Liberty et d’autres organisations de défense des libertés civiles avertissent que cette législation marque un basculement très inquiétant, transformant la contestation pacifique en un acte criminel.
Nous vivons à une époque où dénoncer l’effondrement écologique expose davantage aux arrestations que d’y contribuer. Une telle inversion du droit, de la morale et des priorités est tout simplement indéfendable.
Voilà pourquoi le mouvement en faveur de la criminalisation de l'écocide ce cesse de prendre de l’ampleur.
L’écocide désigne la destruction massive ou durable des écosystèmes, qu’il s’agisse de marées noires dévastatrices, de la coupe rase de forêts anciennes ou de l’assèchement de systèmes fluviaux entiers. En 2021, un groupe d’experts juridiques internationaux en a donné une définition précise et applicable : « des actes illicites ou arbitraires commis en connaissance de la réelle probabilité que ces actes causent à l’environnement des dommages graves qui soient étendus ou durables ».
Cette définition constitue aujourd’hui la pierre angulaire d’un mouvement mondial croissant, qui vise à faire reconnaître l’écocide comme le cinquième crime du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, aux côtés du génocide, des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité et du crime d’agression.
En 2024, le Vanuatu, les Fidji et les Samoa, ont soumis une proposition officielle vvisant à amender le Statut de Rome de la Cour pénale internationale pour y inscrire l’écocide comme crime international. Quelques semaines plus tard, la République démocratique du Congo est devenue le premier pays africain à soutenir l'initiative. Dans le même temps, des legislateurs en Écosse, en République dominicaine, de la Polynésie française, en Italie, au Pérou et ailleurs avancent des projets de lois nationales, témoignant d’un consensus mondial croissant : la destruction massive de la nature doit relever du droit pénal.
Lors d’un événement parallèle à l’Assemblée des États parties au Statut de Rome en 2024, Ralph Regenvanu, envoyé spécial du Vanuatu pour le climat et l’environnement, présente la proposition de son pays visant à ériger l’écocide en crime international. Crédit: Patricia Willocq photography.
Cette dynamique s’étend désormais aux systèmes juridiques régionaux. En mars 2024, l’Union européenne a adopté une Directive révisée sur les crimes environnementaux obligeant les États membres à transposer dans leur droit interne et pénaliser, d’ici 2026, les infractions « comparables à l’écocide ». En mai 2025, le Conseil de l'Europe a emboîté le pas avec une nouvelle Convention sur la protection de l’environnement par le droit pénal, permettant de poursuivre des actes « équivalents à l’écocide ». Plus récemment, la Cour interaméricaine des droits de l'homme a statué que la prévention des dommages environnementaux irréversibles constitue une norme de jus cogens, une règle impérative du droit international à laquelle aucune dérogation n’est possible. Cet avis marque un véritable changement de paradigme juridique, appelé à influencer la jurisprudence en Amérique latine et à renforcer la reconnaissance croissante, au niveau mondial, de la protection de l’environnement comme pilier du droit international des droits humains.
J’ai passé des années dans les salles d’audience à voir des personnes qui défendent la vie pacifiquement qui sont poursuivies en justice, tandis que ceux qui la détruisent échappent aux sanctions. Il est urgent de tracer une limite claire, à la fois juridique, morale et écologique, en affirmant que certains dommages sont trop graves pour être tolérés. Le droit à une planète habitable ne saurait être sacrifié sur l’autel des calculs politiques ou des profits à court terme.
La Cour suprême de Suède a eu raison de rejeter l’idée qu’une manifestation pacifique puisse être assimilée à du sabotage. Pourtant, les défenseurs de l’environnement continuent d’être poursuivis, alors que les crimes les plus graves contre la nature restent impunis.
Nous avons besoin de lois à la hauteur de la crise, et il est impératif de protéger le rôle vital de la manifestation pacifique dans toute démocratie digne de ce nom. Ceux qui alertent sur la destruction massive de l’environnement ne menacent pas la société : ils en sont au contraire les garants de sa survie.