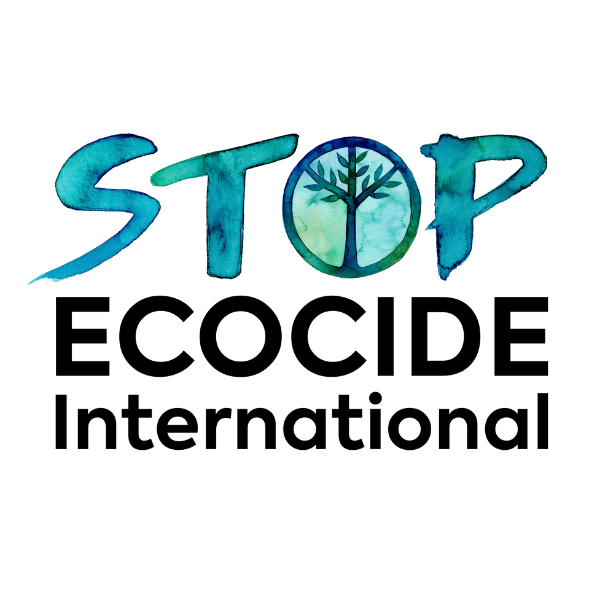la loi sur l'écocide et la montée des systèmes juridiques écocentriques
Ce blogue est rédigé par Paola Vitale, diplômée en droit de l'Université de Bologne, qui se consacre désormais à la défense du droit de l'environnement et du climat.
Il semble souvent que nous ayons oublié à quel point nous sommes étroitement liés à la nature - que nous ne sommes qu'une espèce animale parmi d'autres. Cela reflète une longue tendance historique à nous placer au sommet d'une pyramide, avec les autres espèces vivantes et les écosystèmes en dessous de nous. Cette vision du monde est connue sous le nom d'anthropocentrisme.
Étant donné que le droit reflète toujours ce que nous, en tant que société, considérons comme précieux et digne de protection, notre incapacité à valoriser le monde naturel s'est reflétée dans notre système juridique international. Il est essentiel de comprendre les origines anthropocentriques du droit pour évaluer son influence actuelle sur notre système juridique et trouver un moyen de construire un système juridique plus écocentrique. Heureusement, les cadres juridiques écocentriques prennent de l'ampleur.
L'omniprésence de l'anthropocentrisme
Passage de quatre avions défoliants, dans le cadre de l'opération Ranch Hand. Crédit : Wikimedia.
L'omniprésence de l'anthropocentrisme dans notre société est attestée par le fait que même parmi ceux qui se sont battus pour la protection de l'environnement, des éléments de cette vision hiérarchique du monde sont apparus. Arthur Galston et les scientifiques qui se sont opposés à l'épandage d'herbicides à grande échelle au Viêt Nam dans le cadre d'une opération militaire connue sous le nom d'Opération Ranch Hand, par exemple, se sont délibérément distanciés de l'environnementalisme du milieu du XXe siècle, qui était souvent perçu comme extrême ou fanatique¹. Comme l'a notamment fait remarquer Galston, "dire que quelque chose est naturel ne signifie pas que c'est bon. Ces deux [termes] ne sont pas équitables".
Pour de nombreux scientifiques critiques de l'opération Ranch Hand, ce ne sont pas les atteintes à l'environnement en elles-mêmes qui sont en cause, mais plutôt les conséquences de la destruction des terres et de la végétation sur les êtres humains, en l'absence de tout bénéfice économique ou social. Comme le souligne David Zierler : "Si Ranch Hand était une opération d'extraction de ressources, il ne s'agirait pas d'un écocide"².
Notamment, la prédominance de l'anthropocentrisme persiste dans le droit international (voir ici, iciet ici). A titre d'exemple, l'article 23 du règlement de La Haye interdit les actes qui "détruisent ou saisissent les biens de l'ennemi, à moins que les nécessités de la guerre ne l'exigent impérieusement". Ainsi, la protection s'applique exclusivement aux biens de l'ennemi, laissant sans réglementation les terres non réclamées. De même, l'article 53 de la Convention de Genève limite sa protection aux seuls biens détenus par des particuliers ou par l'État, ce qui permet à la puissance occupante d'agir librement sur les terres non réclamées.
Historiquement, les lois qui protègent l'environnement ne l'ont pas protégé comme une fin en soi, se concentrant plutôt sur la protection de la propriété humaine.
Le changement d'écocentrisme
Approfondissons la question. La criminologie verte définit la relation entre les humains, l'environnement naturel et les animaux non humains à travers trois théories principales : l'anthropocentrisme, le biocentrisme et l'écocentrisme. Comme nous l'avons vu, l'anthropocentrisme est une perspective centrée sur l'homme, fondée sur la perception de la supériorité biologique, mentale et morale de l'homme sur les autres êtres. Les humains sont considérés comme séparés plutôt que comme faisant partie intégrante des écosystèmes, justifiant tout besoin ou désir humain, tel que l'expansion territoriale ou le progrès technologique, au-dessus des considérations écosystémiques.
Le biocentrisme, quant à lui, considère l'homme comme une "autre espèce", attribuant une valeur et une dignité intrinsèques à tous les êtres vivants et dépassant la notion de supériorité humaine.
À mon avis, cependant, le concept le plus convaincant est l'écocentrisme. Cette théorie postule une égalité morale et fondée sur des valeurs entre les êtres humains et les entités non humaines au sein des écosystèmes. Les humains sont considérés comme des intendants responsables parce qu'ils possèdent des capacités uniques et qu'ils ont historiquement permis le progrès de la société par rapport à d'autres espèces. Par conséquent, les activités économiques humaines et l'exploitation des ressources devraient refléter ce rôle protecteur à l'égard du milieu environnant.
Un exemple de loi écocentrique : le fleuve Whanganui, en Nouvelle-Zélande, s'est vu accorder le statut de personne morale en 2017.
Crédit : Newzealand.com.
Malgré les origines anthropocentriques de la plupart des systèmes juridiques, des changements de paradigme vers l'écocentrisme sont évidents au niveau mondial, avec des juridictions qui reconnaissent de plus en plus l'environnement comme une entité digne d'être protégée en tant que telle. Parmi les exemples, on peut citer la Constitution de l'Équateur de 2008 reconnaît Pachamama (Terre mère), la "Loi des droits de la Terre mère" de la Bolivie de 2010 loi bolivienne de 2010 sur les droits de la Terre nourricièreet la reconnaissance du fleuve Whanganui par la Nouvelle-Zélande en 2017 reconnaissance du fleuve Whanganui en tant qu'entité vivante.. D'autres approches plus écocentriques apparaissent dans la Convention ENMOD et le Protocole I de la Convention de Genève. Ces décisions importantes reflètent les changements idéologiques, politiques et de valeurs qui influencent les lois et les règlements. Bien qu'historiquement secondaire par rapport aux besoins humains, la valeur intrinsèque de l'environnement mérite aujourd'hui une protection indépendante.
Comment la loi sur l'écocide aide à construire une perspective plus écocentrique
L'évolution de la la loi sur l'écocide au niveau mondial constitue un autre changement écocentrique majeur. La définition de l'écocide proposée par le Groupe d'experts indépendants (GEI) en 2021 représente un changement significatif vers une perspective écocentrique dans le droit international. Cette définition a servi de base à un nombre croissant d'initiatives législatives nationales, ainsi qu'à la proposition d'un cinquième crime d'écocide présentée à la Cour pénale internationale par les États insulaires du Pacifique, Vanuatu, Fidji et Samoa, en septembre 2024.
Cette proposition au niveau de la Cour pénale internationale est particulièrement pertinente compte tenu des graves limitations de la disposition existante du Statut de Rome sur la protection de l'environnement, qui n'interdit les atteintes importantes à l'environnement que pendant un conflit et seulement dans la mesure où elles ne sont pas excessives par rapport à l'avantage militaire escompté.
La définition du PEI se distingue des dispositions environnementales traditionnelles, telles que l'article 23 du règlement de La Haye ou l'article 53 de la convention de Genève, qui protègent l'environnement principalement dans la mesure où sa dégradation affecte les intérêts de l'homme. Au contraire, cette définition de l'écocide accorde une valeur intrinsèque à l'environnement lui-même.
En considérant les dommages graves et étendus, ou graves et à long terme, causés aux écosystèmes comme un crime international, indépendamment des dommages directs causés à l'homme, cette approche reconnaît l'environnement comme un sujet digne d'être protégé en tant que tel. Une telle perspective renforce le cadre juridique en s'attaquant à des dommages qui pourraient autrement se situer en dehors des seuils anthropocentriques. Ce faisant, la loi sur l'écocide offre une protection plus complète et plus efficace de l'environnement, capable de faire face aux crises écologiques multiformes de notre époque.
1. Zierler, D., L'invention de l'écocide : Agent Orange, Vietnam, and the Scientist Who Changed the Way We Think About the Environment, Athens and London : University of Georgia Press, 2011, p. 18.
2. Zierler, D., L'invention de l'écocide : Agent Orange, Vietnam, and the Scientist Who Changed the Way We Think About the Environment, Athens and London : University of Georgia Press, 2011, p. 18.
RÉFÉRENCES :
Greene, A., "Symposium Exploring the Crime of Ecocide : Rights of Nature and Ecocide", OpinioJuris, (2020).
Zierler, D., L'invention de l'écocide : Agent Orange, Vietnam, and the Scientist Who Changed the Way We Think About the Environment. Athens et Londres : University of Georgia Press, 2011, pp. 1-245.
Brisman, A., et South, N., "Green Criminology and Environmental Crimes and Harms", Sociology Compass 13 (2019), https://doi.org/10.1111/soc4.12650.
Lawrence, J., et Heller, K.J., "The Limits of Article 8(2)(b)(iv) of the Rome Statute, the First Ecocentric Environmental War Crime", Georgetown International Environmental Law Review (2007), p. 4.
Jaffal, Z.M., et al, "Preventing Environmental Damage During Armed Conflict", BRICS Law Journal 5, no 2 (2018), p. 4.