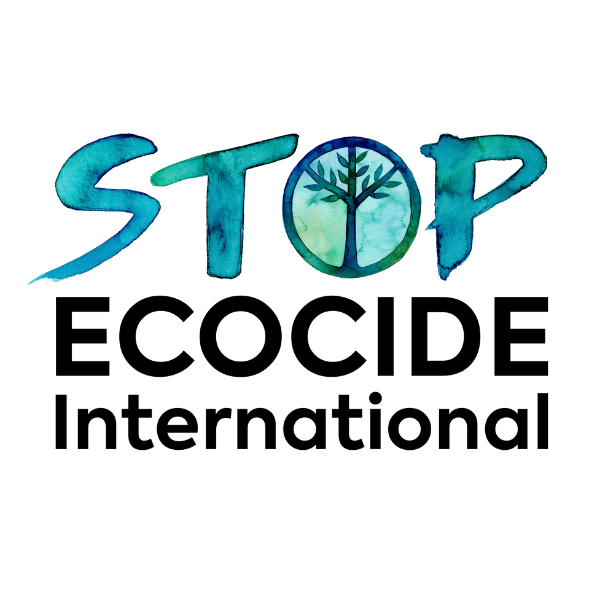« Comparables à un écocide » : le Conseil de l’Europe criminalise les atteintes graves à l’environnement
Résumé
Le Conseil de l’Europe a adopté un traité historique – la Convention sur la protection de l'environnement par le droit pénal – qui définit et criminalise un large éventail d’infractions environnementales. Ce texte instaure un cadre juridique permettant aux États de poursuivre en justice les actes intentionnels à l’origine de catastrophes écologiques comparables à un écocide.
Adopté par le Comité des Ministres le 14 mai 2025 le traité est à présent disponible pour signature. Il prendra effet après sa ratification par au moins dix États, dont huit doivent être membres du Conseil de l’Europe, conformément à l’article 53(3). La signature et la ratification restent néanmoins des démarches volontaires pour les États.
Bien que le terme « écocide » ne soit pas utilisé dans les dispositions opérationnelles, le préambule de la Convention y fait explicitement référence. Par ailleurs, ses dispositions relatives aux infractions particulièrement graves et aux circonstances aggravantes reprennent largement la définition de 2021 proposée par le Groupe d'experts indépendants réuni par la Fondation Stop Ecocide.
Adoptée en parallèle de la Convention, la Stratégie environnementale quinquennale du Conseil de l’Europe insiste sur le renforcement de l’application des lois, la protection accrue des défenseurs de l’environnement et l’amélioration de l’accès à la justice. Avec la révision de la Directive européenne sur la criminalité environnementale et la proposition officielle de 2024 portée par les États insulaires du Pacifique pour inclure l’écocide dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI), il s’agit là de la troisième avancée majeure en moins d’un an dans l’utilisation du droit pénal international pour prévenir et sanctionner les atteintes environnementales les plus graves.
Principales dispositions et avancées juridiques
Le Conseil de l’Europe a officiellement adopté la Convention sur la protection de l'environnement par le droit pénal, un nouveau traité international qui impose aux États l’obligation d’incriminer un large éventail d’infractions environnementales graves. Adoptée par le Comité des ministres le 14 mai 2025, la Convention est désormais ouverte à la signature des 46 États membres du Conseil de l’Europe ainsi que d’autres États invités. Elle entrera en vigueur dès que dix États, dont au moins huit membres du Conseil de l’Europe, l’auront ratifiée.
Ce traité définit et érige en infractions pénales diverses atteintes à l’environnement. Selon les termes mêmes du Conseil de l’Europe, il «permet aux États de poursuivre en justice les actes intentionnels entraînant des catastrophes environnementales comparables à un écocide ».
Principales dispositions et avancées juridiques
La Convention fixe des standards juridiques minimaux que les États doivent intégrer dans leur droit national pour lutter contre la criminalité environnementale. Elle vise des infractions telles que la pollution illégale, la destruction d’écosystèmes, le trafic de déchets et la détérioration grave des habitats naturels.
Une innovation majeure réside dans la reconnaissance des « infractions particulièrement graves », désignant les actes causant des dommages irréversibles, durables ou étendus à l’environnement — une terminologie qui reflète étroitement la définition de l’écocide proposée en 2021 par le Groupe d’experts indépendants mandaté par la Fondation Stop Ecocide.
Si le terme « écocide » n’est pas utilisé dans le corps du texte, sa présence dans le préambule et la gravité des infractions décrites font de cette Convention la reconnaissance la plus claire du concept à ce jour dans un cadre juridique européen contraignant. La mention de circonstances aggravantes, notamment en cas de dommages écologiques durables, vient renforcer cette orientation.
Le texte prévoit également des sanctions spécifiques pour les entreprises, allant des amendes à l’interdiction d’exercer certaines activités, en passant par des injonctions de réparation environnementale. Il introduit des protections renforcées pour les défenseurs de l’environnement et les lanceurs d’alerte, et garantit un meilleur accès du public à l’information et à la participation aux décisions environnementales.
Quels jalons avant l’application effective de la Convention ?
La Convention ne s’applique pas automatiquement. Pour qu’elle devienne juridiquement contraignante, chaque État doit d’abord la signer — acte symbolique marquant un engagement politique — puis la ratifier selon ses procédures nationales. Certains pays pourraient entamer ce processus rapidement, tandis que d’autres pourraient tarder ou choisir de ne pas y participer. La mobilisation de la société civile sera déterminante pour favoriser une adoption large et une mise en œuvre effective.
Un pilier dans une stratégie environnementale globale
Ce traité s’inscrit au cœur de la Stratégie environnementale 2025-2030 du Conseil de l’Europe, adoptée parallèlement par le Comité des ministres. Cette stratégie identifie cinq priorités majeures, dont l’une est la lutte contre la criminalité environnementale.
Elle encourage expressément la ratification de la Convention, le renforcement de l’accès à la justice, une responsabilité juridique accrue en matière de préjudices environnementaux, ainsi qu’une meilleure protection des défenseurs de l’environnement. Elle établit clairement que la protection de l’environnement est une condition essentielle à l’exercice des droits humains et à la préservation des valeurs démocratiques.
Un tournant mondial vers la responsabilité environnementale
Avec cette Convention, c’est une troisième avancée majeure en droit pénal international de l’environnement qui se concrétise en moins d’un an, après la révision de la directive européenne sur les crimes environnementaux — qui reconnaît désormais des actes comparables à l’écocide — et la proposition officielle soumise par des États insulaires du Pacifique pour inscrire l’écocide dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.
Cette évolution marque un changement de cap vers des règles internationales contraignantes, remplaçant progressivement les engagements volontaires, pour prévenir, dissuader et sanctionner les atteintes environnementales les plus graves.
Jojo Mehta, directrice générale et cofondatrice de Stop Ecocide International, a déclaré :
« En criminalisant la destruction de l’environnement comparable à un écocide, ce traité marque un tournant historique dans le droit de l’environnement. Il consacre l’idée que les atteintes massives à la nature ne relèvent pas d’un simple manquement réglementaire, mais constituent des crimes devant être poursuivis en justice. Cette Convention pourrait désormais servir de modèle pour des réformes à l’échelle mondiale, bien au-delà du cadre européen. »
« Il ne fait plus de doute que notre rapport à la nature évolue, et que nos cadres juridiques s’adaptent en conséquence, contribuant ainsi à ancrer une nouvelle conscience – essentielle – de notre responsabilité envers le monde vivant dont nous dépendons totalement. »
« Encourageons les États non seulement à signer et ratifier cette Convention essentielle, mais aussi à reconnaître que les atteintes environnementales graves, étendues ou durables – autrement dit l’écocide – doivent systématiquement être interdites et poursuivies comme des crimes majeurs, même si leur mode de commission n’est pas précisément décrit dans le traité. La logique est implacable, tout comme l’est notre interdépendance avec les écosystèmes qui nous maintiennent en vie. »
-
Le texte intégral de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection de l’environnement par le droit pénal est disponible ici tout comme la Stratégie environnementale 2025–2030 du Conseil de l’Europe ici.